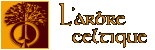Les mystﺣ۷res insondables, dignes de la ville dﻗYs, de lﻗﺣ۸volution maritimo-commerciale et de lﻗﺣ۸cheveau des grands axes de navigation mer/fleuves sur la faﺣ۶ade Atlantique ont de quoi nous laisser perplexes.
Ainsi Burdigala ou lﻗimpitoyable, mais belle histoire ﺣ lﻗenvers, ﻗ en clin dﻗﺧil et en deux volets ﻗ dﻗune ville portuaire gauloise, dﻗavant lﻗﺣ۸poque romaine, et qui aurait eu de quoi, de prime abord, et donc a priori, sﻗenorgueillir de dﺣ۸couvertes fracassantes.
Pourtant, plouf dans lﻗeau !!!
Bordeaux - L'histoire
Bordeaux, l'autre capitale
Toute ville a son mystﺣ۷re, son secret intime. Bordeaux le conserve, rive gauche, dans une sorte d'obstination gasconne ﺣ ne pas se dﺣ۸ployer au nord. Fiﺣ۷re et frondeuse, Bordeaux la Girondine saura ne jamais se soumettre ﺣ ses envahisseurs et maﺣ؟tres successifs. L'opulence de la citﺣ۸ marchande n'aura pas peu contribuﺣ۸ ﺣ garantir cette belle indﺣ۸pendance de cﺧur et d'esprit.
Gﺣ۸rard Guicheteau
http://www.lepoint.fr/dossiers_villes/d ... did=129566
ﺡ۸ le point 25/04/03
Au commencement du monde, il y avait les Graves, deux ou trois basses collines d'alluvions et de cailloux en pente douce, un espace que cernaient les forﺣ۹ts et que ravinaient deux courtes riviﺣ۷res et l'eau ﺣ۸chappﺣ۸e des fonts. Rive droite, sur des falaises de calcaires et de mollasses creusﺣ۸es de grottes, au-delﺣ d'un marﺣ۸cage recouvert et dﺣ۸couvert selon les marﺣ۸es, de petits hommes se chauffaient au soleil entre deux chasses ﺣ l'auroch ou ﺣ l'ours. Bordeaux n'ﺣ۸tait encore que ﺡ، ﺣ۶a ﺡﭨ : une plage de graves inclinﺣ۸e vers la Garonne et deux criques perpendiculaires au fleuve, les embouchures de la Devﺣ۷ze et du Peugue.
Cependant, la vﺣ۸ritable nouveautﺣ۸ historique allait ﺣ۹tre l'entrﺣ۸e en scﺣ۷ne d'une grosse barque remontant cette fois le courant, portﺣ۸e par le flux de la marﺣ۸e comme une branche morte, voile affalﺣ۸e. La barque arrivait, disait-on, des terres borﺣ۸ales qui, au-delﺣ du fleuve Ocﺣ۸an, fournissent le fer et l'airain, le plomb et l'ﺣ۸tain, l'or et l'argent, les pierres prﺣ۸cieuses et l'ambre. Elle inaugurait la voie la plus courte entre l'Atlantique et la Mﺣ۸diterranﺣ۸e. Il ne serait plus nﺣ۸cessaire de contourner la pﺣ۸ninsule des Ibﺣ۷res ou de longer l'Afrique. Des ﺣ۸changes commenﺣ۶aient entre ce que les marins aventureux allaient chercher au Nord, au milieu des glaces, des brumes et des rochers dﺣ۸chirants, dans ces ﺡ، ﺣ؟les ﺡﭨ que Strabon dﺣ۸crivit, et ce qui venait de la Grande Grﺣ۷ce ou de la Phﺣ۸nicie.
Les premiers habitants des Graves allaient se tenir cois jusqu'ﺣ ce que survﺣ؟nt du cﺧur de la Gaule, de l'intﺣ۸rieur de la boucle d'un autre grand fleuve, la Loire, un peuple gaulois indﺣ۸pendant d'esprit et de mﺧurs, les Bituriges - les Vivisques (vibisci) comme ils se nommaient pour se distinguer des Berrichons, les Bituriges cubi. Burdigala ﺣ۸tait fondﺣ۸e sous ce nom ; elle allait s'agrandir et devenir un emporion (un comptoir) majeur.
Burdigala, castrum et comptoir
Ainsi, la ville se fit par le commerce, uniquement par le commerce. On peut mﺣ۹me dire qu'elle en ﺣ۸tait l'essence, comme le seront avec elle, mais plus tard, Londres, Venise, Anvers ou Lﺣﺙbeck. Et commerce veut dire ﺣ۸changes, ouverture, voyages, idﺣ۸es larges sur le large. Pour vendre, pour acheter, il fallait aller loin et imaginer. Sur place, le profit eﺣﭨt ﺣ۸tﺣ۸ maigre. Pour la bonne raison que Burdigala s'ﺣ۸difiait au centre d'un dﺣ۸sert de ﺡ، landes ﺡﭨ. Et que le ﺡ، bassin de population ﺡﭨ n'ﺣ۸tait pas assez important pour ﺣ۸puiser les stocks. Mais les Bituriges, gens avisﺣ۸s, ﺣ۸taient lﺣ pour ﺣ۹tre des marchands, des entrepreneurs de croisiﺣ۷res, et non pour faire les marins. ﺣ cette tﺣ۱che, ils allaient employer de rudes spﺣ۸cialistes qui avaient fait leurs preuves : des Basques, des Ibﺣ۷res, des Santones, des Bretons.
Quand les lﺣ۸gions romaines ﺡ، pacifieront ﺡﭨ la Gaule, les Bituriges vibisci accepteront volontiers les vainqueurs, car l'ordre favorise le commerce. Ils ne se fourvoieront pas avec les guerriers ﺡ، chevelus ﺡﭨ de Vercingﺣ۸torix. S'ils se montrﺣ۷rent ﺣ Rome pour le triomphe, ﺣ la suite de Jules Cﺣ۸sar et de Publius Crassus, chef des lﺣ۸gions conquﺣ۸rantes, ce fut ﺣ titre de marchands, pas de vaincus. Plus tard, Bordeaux deviendra une des capitales de la province d'Aquitaine qui s'ﺣ۸tendait de la Loire aux Pyrﺣ۸nﺣ۸es. Mais elle s'installera uniquement sur la rive gauche. Ville ouverte, d'abord, puis ﺡ، ville carrﺣ۸e ﺡﭨ, ceinte de murailles, au carrefour des routes venant ou conduisant au Mﺣ۸doc, aux ports de l'Adour et aux villes gallo-romaines de Marmande, Agen, Montauban, Toulouse. Le Nord s'arrﺣ۹tait rive droite, face au forum. La batellerie rﺣ۸gnait.
La paix romaine, qui dura quatre cents ans, a lﺣ۸guﺣ۸ ﺣ la citﺣ۸ l'ordonnancement de sa partie centrale, des reliefs de constructions et des noms de rue tels que ﺡ، Piliers de Tutelle ﺡﭨ ou ﺡ، Ausone ﺡﭨ. La premiﺣ۷re appellation perpﺣ۸tue le souvenir d'un temple ﺣ la divinitﺣ۸ tutela (tutﺣ۸laire), protectrice de Bordeaux ; la seconde cﺣ۸lﺣ۷bre l'ﺣ۸crivain latin bordelais Decimus Magnus Ausonus, Ausone (310-385), fils de Jules, qui fut prﺣ۸cepteur de l'empereur Gratien, puis prﺣ۸fet des Gaules, consul et propriﺣ۸taire de vignobles. Le principal dieu romain de Burdigala, nul ne s'en ﺣ۸tonnera, fut et resta Mercure. Comme se plaﺣ؟t ﺣ le souligner Camille Julian (un Marseillais, historien de Bordeaux et grand spﺣ۸cialiste de la Gaule, contemporain d'Ernest Lavisse) : ﺡ، Il n'y a pas de dieu dont on trouve ici plus de statues... ﺡﭨ Jupiter, alias Jovis en latin, n'a droit qu'au souvenir d'un temple, par la rue et la Porte Dijeaux. Bacchus, plutﺣﺑt que Dionysos, demeure prﺣ۸sent par une autre sorte de don, la vigne et le cﺣ۸page biturica.
ﺡ۸ le point 25/04/03 - Nﺡﺍ1597 - Page 216
http://www.lepoint.fr/dossiers_villes/d ... did=129566
e. I/II